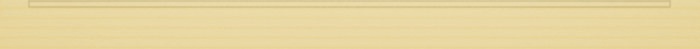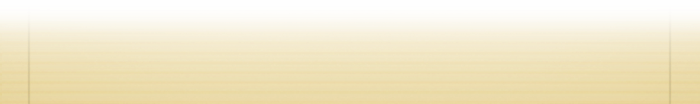Ce tableau représente indubitablement un paysage inspiré de la campagne de Rome, pour un projet en cours de réalisation. Avant de rentrer dans le secret des dieux, voyons tout d’abord l’impression première sur la topographie, exécutée de l’atelier de Poussin, acquis vers 1630, en haut de la Trinité des Monts. L’essentiel du décor est constitué par trois éléments: les rochers, les bois, les collines.
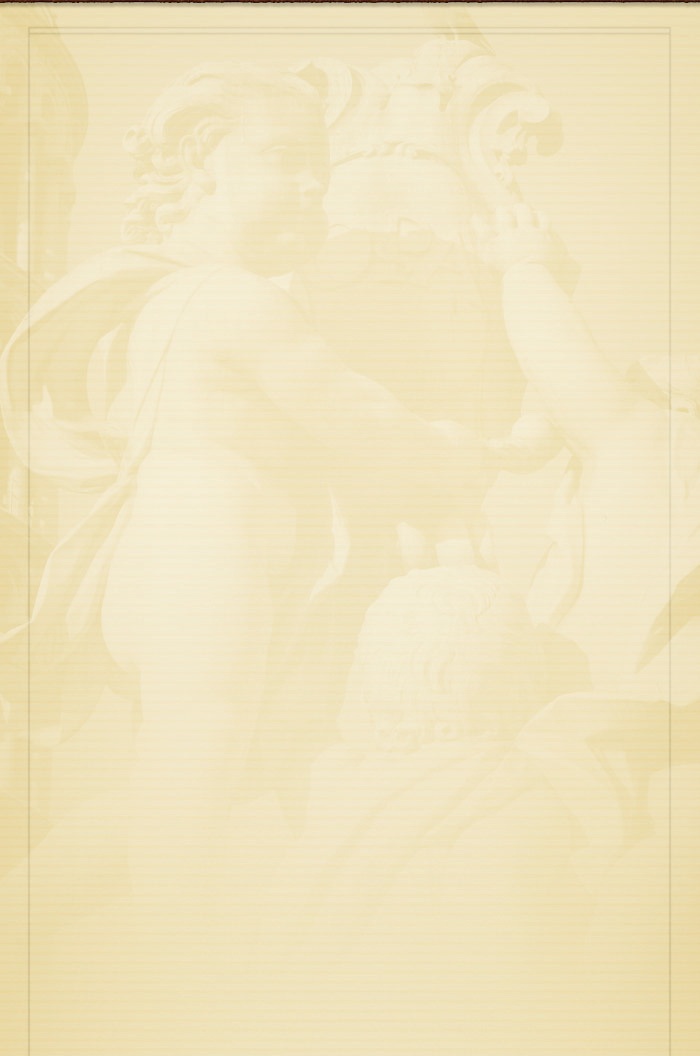









Chapitre 1
Au premier plan à gauche, coule une rivière, bordée d’arbres, de rochers et de feuillages qui se reflètent dans l’eau avec une transparence étonnante et dans une lumière diffuse. A gauche et à droite, la composition est fermée par des arbres dont le feuillu aux couleurs d’automne est traité par touches allongées d’une parfaite immobilité. Au pied de ces arbres, un feuillage semblable au lierre, mais aux feuilles plus larges, grimpe le long du tronc, jusqu’à mi-hauteur environ. Au centre du premier plan, un arbuste pousse au milieu du rocher, parsemé de petites fleurs blanches dont la luminosité donne du relief à ce tableau, plongé dans la pémombre. Cet arbuste mentionné sous le N°13 d’une expertise florale, entre le 17 et le 20 février 1978, porte le nom de Pistachia-Myrtus, phyllirea.

Tous les peuples riverains de la méditerranée ont porté une affectueuse vénération au myrthe, dont la senteur, à la fois ardente et suave, embaume l‘air alentour. Petit arbre de 4 à 5 m. de haut, il forme le plus souvent des buissons arrondis et touffus, au feuillage persistant d’un vert vif et brillant. L’espèce, typiquement méditerranéenne croit surtout près du littoral. Elle abonde en Corse, mais se trouve aussi dans les maquis et les garrigues de Provence, ainsi que dans les parties les plus chaudes du Languedoc et du Roussillon.
Au début de l’eté, l’arbrisseau se couvre d’une multitude de fleurs délicates et très parfumées, d’un blanc pur. C’était pour les anciens l’image même de la grâce virginale. A Rome, avec un climat chaud et humide, il en pousse à deux saisons: au printemps et à l’automne. On en trouve encore sur le Palatin.
Pline ajoute que Romulus planta à Rome deux myrthes, l‘un desquels devint bientôt cher aux patriciens, l’autre au peuple. Lorsque à Rome, les nobles triomphaient, c’était le myrthe des patriciens qui se desséchait à son tour. Les piétons romains en voyage se procuraient un anneau de myrthe, comme un viaduc heureux. Il parait que Pallas et Mars avaient adopté à leur tour le myrthe. Dans un dessin de Pompée, on voit un prêtre de Mars avec une couronne de myrthe. On raconte qu’une jeune fille nommée Myrène , prêtresse de Vénus, pour avoir voulu épouser un garçon qu’elle aimait, fut changée en myrthe(1)...
A droite, une femme appuyée contre un rocher et drapée dans une étoffe blanc et bleu, montre le chemin à un homme qui tient apparemment un simple bâton pour contenir sa marche. Lorsqu‘on regarde de plus près le haut de ce bâton, il y a sur la droite un crâne. Le haut du pommeau se termine sous la forme d’un soleil! L’illustre voyageur a une démarche majestueuse. Sa cheville droite est transpercée par une vouivre. Sa tête est posée sur les orteils du pied gauche. Le genou semble avoir la forme d’une tête. La main gauche, est tout simplement une patte d’ours. Au creux du thorax à droite, se dessine une forme bizarre qui ressemble bien à une coquille Saint-Jacques. Sur le haut de la tête, on distingue un tau. La tunique de couleur rouge flotte par un vent venant du Nord. La position des doigts du voyageur et de la jeune femme est identique. Le pouce et l’index sont tendus vers la même direction des bâtisses, entourés d’un rempart.
Au deuxième plan, une femme se repose auprès de son enfant. L’écume de l’eau souligne la bordure de cette plage. Elle est vêtue également de draperies blanc et bleu. Un peu en arrière, un homme habillé d’une tunique jaune, bleu et rouge, se dirige alertement vers le tournant du chemin, qui disparait derrière un bosquet d’arbres.
Au centre, à l’arrière plan, une colline se dresse, surmontée d’une construction antique. Au fond du tableau, les collines environnantes s’étendent à perte de vue: à droite dans l’obscurité crépusculaire, à gauche dans la lumière et les vapeurs d’un soir d’automne romain. La lumière elle-même venue de loin hors de la toile, éclaire horizontalement les nuages roses et dorés qui roulent dans un ciel bleu soutenu. L’éclairage portant sur la partie supérieure des personnages jette une demi-obscurité. L’ensemble des éléments qui composent cette toile, tant pour la composition elle-même, que pour les couleurs et la lumière, fait immédiatement penser à l‘un des plus grands maîtres de la peinture française du XVIIe siècle.
•II-Description de la Rome antique
Le peintre a indubitablement pris pour composer son paysage les éléments de la Rome antique.
•1)L’ancienne route du sel
Nous avons mentionné plus haut que la toile représente un paysage dont la composition s’ordonne autour d’une rivière serpentant et disparaissant derrière un rocher. Le chemin qui le contourne monte vers la colline du Vatican et va se perdre au milieu des arbres. Il représenterait l’ancienne route du sel descendant du Pinchio qui était autrefois l’entrée de Rome. Il existe en effet, dans les archives de la bilbliothèque Herziena, un dessin daté de 1458, représentant ce chemin, avant la construction du cloître et l’église de la Trinité des Monts. Un autre dessin du XVIIe siècle représente deux voyageurs avec le mulet chargé d’un ballot, mais au lieu de descendre vers la place d’Espagne, ils longent la colline. Ce chemin serait celui qu’emprunta le légendaire Hercule, afin d’accomplir sa mission...
Reproduit par Serge Tiers, étudiant à l’école de restauration des beaux-arts à Valence, en mars 1978

2)Voyage symbolique à travers l’histoire
En réalité, c’est un voyage à travers l’espace, mais plus encore à travers le temps. Les personnages assemblés par groupes, à la manière poussinesque sont si bien disposés et s’expriment par des actions si intelligibles, que l‘on croirait comprendre tout d’un coup l’histoire qu’il a voulu raconter.
Les deux femmes, celle qui montre le chemin en direction du Vatican, appuyée contre le rocher, et celle qui est assise plus loin au bord de l’eau, semblent représenter dans le onzième travaux d’Hercule Espéria et Aréthuse, les deux nymphes du soleil couchant. Elles sont drapées à l’antique, dans des vêtements qui marquent la forme du corps, et les cheveux sont maintenus par un diadème ou une couronne.
Le voyageur situé au premier plan devrait être Hercule et celui dans le lointain, qui fait avancer les chevaux dans le sentier et qui porte la tunique courte retenue à la taille, devrait-être son cousin Jolaos!
La distribution des couleurs avec d’une part le blanc et le bleu, là où la lumière procède d‘un mode souverain, éclaire les épaules et le haut du corps des personnages du premier et du second plan; d’autre part le jaune au troisième plan, là où les personnages ne reçoivent qu’un jour glissant et où la couleur compense par sa nature et son éclat le défaut de lumière. Ce sont là les couleurs préférées de Nicolas Poussin.
Tout dans la composition des corps rappelle aussi la manière du peintre lors de ses dernières années: la vigueur des membres, le renflement des muscles, l’équilibre qui maintient le corps dans une position ferme et contribue à l’harmonie de la scène, la symbolique classique si scrupuleusement respectée que les visages ressemblent plus à des masques antiques qu’à des personnages réellement vivants. Il y a enfin cette parfaite maîtrise de l’art de la perspective et de l‘optique, grâce à laquelle les personnages vus de loin marquent si parfaitement, par l’affaiblissement des couleurs, la quantité d’air qui les sépare de l’observateur, „qu’il semble que l‘on chemine dans tout le païs qu’il représente“(2)...
Avant de poursuivre l’acheminement de nos voyageurs légendaires, revenons au rocher où est appuyée la jeune femme du nom d’Hespéria, l’une des deux nymphes du soleil couchant. Ce rocher semble représenter une tête ou un crâne de forme diffuse et le chemin, les épaules d’un géant! L’antique ville de Rome dessine une tête que la légende du géant Olus confirme par un nom révélé par un prêtre-divin étrusque, et très homophone d’Olen, le bras de Latone. Quand en effet, on creusa les fondations du temple de Jupiter Capitolen à Rome, les ouvriers trouvèrent une gigantesque tête d’homme, qu’un devin révéla être le crâne du géant Olus. Le temple prit ainsi le nom de Capitole ou Caput-Oli en latin, la tête d’Olus. „Serait-ce un présage de la future grandeur de Rome qui deviendrait la tête du monde?“(3) Quant à la main qui tient le bâton, c’est en fait une patte d’ours symbolisant la descendance mérovingienne qui portera dans un blason „de gueules à une patte d’ours d’or“.
Là où ce rocher s’harmoniserait à ce paysage, il s’agit bien, dans l’histoire antique, du jardin des Hespérides. Poussin cite le passage, au momment où Hercule demande à celle qui représente Hespéria, le jardin des pommes d’or(4). Au-delà de ces symboles, le rocher marque le croisement des chemins ou des frontières(5). Ce rocher était la plus ancienne divinité païenne.
L’île des Veilleurs d’Alfred Weysen, Robert Laffont 1986, p334 et Le croisement des chemins ou des frontières

Atlas transformé en rocher, symbolisé par la suite sous le nom de Mercure, le guide des voyageurs et le Dieu qui présidait aux chemins(6)
•3)Les Grands Travaux du Vatican
Poursuivons ce chemin et nous trouvons à droite, au-delà du bosquet d’arbres, un groupe de fabriques et une construction ronde . Nul doute qu’il s’agit ici du château Saint-Ange. La figuration de ce monument est particulièrement significative de la vision historique du peintre. La base carrée du mauselé est ici rendue invisible par le feu de la végétation et de la perspective. Seule apparait la partie cylindrique du monument, telle qu’elle fut construite en l’an 139 aprés J.C. surmontée d’une petite colline, au sommet de laquelle s’élève une colonne carrée, base probable d’une statue d’Hadrien. C’est donc le monument d’Hadrien tel qu’il se présentait après l’an 139 et avant les fortifications d’Aurélien de l’an 271, duquel Poussin s’est inspiré.
Le château St-Ange et le canal d’Agrippa

Tout à côté, à l’emplacement de l’ancien cimetière s’élèvent quelques constructions qui sont certainement d’une époque plus tardive puisque c‘est seulement au VIe siècle que le pape Symmaque (498-514), chassé par Théodoric, songea à se réfugier au Vatican, qui jusqu’alors ne comportait que la basilique au bas de la colline, et fit édifier dans la plaine des bords du Tibre quelques „Episcopia“ pour y loger la cour. Il est impossible de savoir si le peintre a voulu ici représenter les bâtiments du Ve siècle ou ceux qui furent édifiés par le pape Léon III à la fin du VIIIe siècle, où Charlemagne lui-même fut hébergé! Nous pencherons quant à nous, pour les constructions du pape Symmaque, en raison de l’aspect massif et austère de ces bâtiments, aux murs percés de grandes fenêtres et d’ocoulis, qui les rattachent plutôt à la tradition architecturale antique. C’est seulement sous Alexandre VI, de 1493 à 1503, que l’on transforma le tombeau en forteresse. Les travaux continuèrent sous Pio IV, en 1654. Sous Urbain VIII, on construisit de nouveaux bâtiments. De 1656 à 1659, Antonio Maccinelli refit les mâchicoulis, une porte en fer à l‘entrée du fort. L‘ange de la tour fut rehaussé sur un piédestal et on remplaça la perche. Ce lieu s’appelait le petit champs de Mars.
A gauche de la toile, derrière la colline et à droite des arbres du premier plan qui viennent rompre la monotonie d’une perspective uniforme, c’est le quartier du Trastevere, l’ancien grand champs de Mars, au milieu duquel s’élève une basilique, à l’emplacement actuel de l‘église Santa-Maria in Trastevere. Nous savons par la chronique d’Eusèbe de Césarée qu’en l’an 30 avant J.C., jaillit à cet endroit tout près de la Taberna Meritoria, une fontaine d’huile minérale et que ce miracle, considéré ensuite comme annonce prodigieuse de la venue du Christ suscita la construction d’une église sous le Pontificat de Callixte I (217-222) et sous le règne de l’Empereur Alexandre Sévère!

4) Autre vue de la Rome antique
En face et au milieu de l’eau, l’île Tiberina se présente aussi, dans sa forme primitive, encore acompagnée de petites îles que le Tibre dévorera, comme une campagne à l’état naturel, au milieu de laquelle s’élève encore une basilique. C’est le temple de Faunus ou plutôt le fameux temple de l’Esculape, où se trouvait le simulacre du serpent transporté par Epidaure, sans doute reconstruit au IIIe siècle. Sur les ruines de celui-ci s’élèvera au Xe siècle San Adalberto e Paolino, devenus plus tard San Bartolomeo à la mémoire de l’évêque Adalberto, en l’an 997, sous le règne du pape Léon IX.
En 1284, de grandes innondations emportèrent les colonnes Porfido du Mtre Toussaint Siboire. En l’année 1624, Ottoma III, l’église et l’hôpital furent reconstruits par l’architecte Martino-Longhi. En 1656, la peste ravagea Rome... Le pape Alexandre VII fit assécher le marécage autour de l’île Tiberina. C’est donc bien une vision historique de la Rome antique où se mêle en d’autres lieux, une histoire qui se déroule sur peut-être plus de deux mille cinq cents ans et qui se trouve résumée dans cette toile.
C’est une vue intellectuelle en partie de cette cité, telle qu’un peintre aussi amoureux de la nature et de l’antiquité que le fut Poussin pour la créer! Mais si les éléments architecturaux et l’omniprésence de la campagne sont une recomposition d’historien dans un temps disloque, la perspective qui a été peinte provient sans aucun doute de l’atelier de Nicolas Poussin, situé sur le Pinchio, à droite de la Trinité des Monts et acheté par l’artiste lors de son mariage avec Marie Dughet en 1630. En 1652, Salvador Rosa vint rejoindre Poussin et Claude Lorrain. Ce dernier demeurait dans l’ancienne demeure des Zuccari.
De ce panorama, on peut admirer, au-delà de la Piazza del Popolo qui forme l’actuelle Piazza d’Espagna, le premier plan de notre tableau, dans une lumière d’automne: un coucher de soleil, aux teintes roses et dorées à l’heure „où l‘air est si pur et serein, et où les objets éclairés des rayons du soleil qui baissent, se font voir avec plus de douceur et de tendresse“(7).

•5)Le Janicule et sa forteresse
Poursuivons encore notre promenade et laissons-nous conduire vers la ligne d’horizon et la lumière de Rome. Cette montagne qui se dresse au milieu de la toile, c’est le mont du Janicule dans son état primitif, surmonté de constructions antiques, édifiées à l’emplacement du temple d’Isis. La forteresse du roi Sabin Ancus Martius, percée des deux portes de Janus était déjà en ruines à l’époque de Pline. Ses restes, mêlés peut-être à d’autres constructions médiévales demeurèrent encore visibles, du moins jusqu’au XVe siècle au sommet de la colline. Il est à remarquer qu’ici, Poussin n’a pas fait une oeuvre entièrement originale...
Elevé à l’école de Raphaël et nourri des oeuvres de ce dernier pour lequel il eut toujours la plus profonde admiration, il a probablement reproduit la montagne couronnée de ruines qui compose le fond du tableau de la „Transfiguration“ peint en 1517. Raphaël fut nommé en 1515 commissaire des antiquités. Vers 1518-1519, il supplia Léon X de sauvegarder les vestiges antiques. Il proposa en ce sens d’effectuer leurs relevés exacts, la coupe et l’élévation de ces monuments.
En 1520, Raphaël a commencé son travail et Rome se voit rétablie en majeure partie de sa figure antique, en son pourtour primitif et dans les proportions de ses parties diverses. Dans ce but, Raphël a fait entreprendre des fouilles à l’intérieur des collines et des fondations profondes et les résultats concordent avec les descriptions et les dimensions fournies par les auteurs anciens. Le plan de Raphël comprendrait 16 feuilles(8)..., les 16 régions de la Rome antique!
Ce sont ses amis et élèves qui vont en partie réaliser son voeu: 1527, plans „Antiquates Urbis“ de Andrea Fulvio; 1544, „Urbia Romae Topographia“ de Bart Marliano; 1518-1519 sur les bases et fondations antiques, Turini fit construire une villa...du nom de Lante(9). Les décorations furent exécutées par les élèves de Raphaël. Cette demeure achetée et restaurée, appartient depuis 1948 à l’ambassade finlandaise. C’est en 1656, que le Vatican fit applanir cette colline du Janicule pour en faire un jardin d‘agrément. Ces travaux se sont terminés en même temps que les rénovations du château Saint-Ange en 1659.
Au pied du Janicule, un bosquet d’arbres symbolise peut-être le bois de chêne vert qui recouvrait dans l’antiquité les monts du Vatican et où naquit le culte de la nymphe Furrina, divinité des bois sacrés et d‘une source, dont l’eau coule vers le devant de la toile, entre les rochers, les arbres et les fleurs...
Samothés, dit Janus – Mont Tabor, Tarentum

Nous sommes vers les années 1650-1660, au moment où Rome resplendit au milieu de ses nouveaux palais. Des bâtiments à gauche de la cour d’honneur du Vatican vinrent prendre place, là où subsiste le dernier vestige de ce bois sacré. Au pied du Janicule, près du Vatican, Pline parle d’une yeuse „chêne vert“ plus vieille que Rome. Plus tard, on planta une vigne, qui rendit un vin au goût de vinaigre, dont disait Martial. „Boire le vin du Vatican, c’est boire du poison(10)“.
Les maisons de Rome furent couvertes avec des bardeaux jusqu’à la guerre de Pyrrhus, pendant 470 ans. Il est certain que des forêts remarquables étaient répandues dans son enceinte. Aujourd’hui encore le nom de Jupiter Fagutal indique l’emplacement d‘un bois de hêtres... des chênes étaient à la porte querquetulane... on allait chercher des osiers à la colline vitimale... et, tant de lieux où se trouvait un bois et même deux. „Après la retraite du peuple sur le Janicule, an de Rome 367, D. Hortensius dictateur, porta dans l’Escalatum „bois de chênes“(11).
Enfin, au pied du Janicule sur la droite, une ligne horizontale plus sombre barre le paysage. C’est vraisemblablement le canal construit à l'époque impériale pour alimenter les bains d'Agrippa. Les vestiges de ce canal furent mis à jour lors des aménagements de ce jardin. Quelques restes de monuments sacrés s’élèvent au milieu d‘une campagne paisible. Au-delà de cette colline, c’est l’histoire de tout un quartier de la Rome antique qui se déroule sous nos yeux, telle quelle se présentait dans l’imagination de l’artiste.